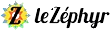Rencontre avec Jérémy Lemarié, docteur en sociologie et rédacteur en chef du webzine Surfblurb. Il vit le surf comme un mode de vie, une philosophie qui guide son quotidien.
Jérémy Lemarié nous reçoit à Nanterre à l’université, où il a durant le semestre dernier enseigné quelques cours de sociologie. Il a plutôt l’air satisfait de m’accueillir dans une salle réservée aux professeurs pour parler surf. « Cela me permet de réviser mes fondamentaux », dit-il en souriant. Mais, entre nous, il n’en a pas besoin, tant il maîtrise parfaitement son sujet.
Cela lui fait plutôt plaisir de me raconter l’histoire du surf, comment cette discipline qui consiste à glisser sur l’eau est passée d' »une pratique autochtone à un sport mondialisé« , dont raffolent plusieurs millions de personnes dans le monde. C’est d’ailleurs un bout du titre de sa thèse qu’il a soutenue en 2016 et qui s’intitule : « Genèse d’un système global surf. Regards comparés des Hawai’i à la Californie : traditions, villes, tourismes, et subcultures (1778–2016) ». Pendant plus de trois heures, il évoque Hawaï, où il a eu la chance de vivre, la Californie, où il a passé une partie de ses études. Il décrypte pour nous l’évolution de l’image du surfeur au fil des décennies, l’arrivée de cette pratique de glisse en France, la professionnalisation de ce sport qui en a choqué plus d’un. Sans oublier de parler de lui. Car, naturellement, lui-même enfile parfois sa combinaison pour se jeter avec gourmandise (et dés 5 heures du mat’) à l’eau pour chercher « la vague de sa vie ». Rencontre avec un docteur en sociologie qui vit au rythme de l’océan – et jamais sans sa planche.
Vous en êtes à l’épisode 2 de l’entretien.
Lire l’épisode 1
Lire l’épisode 3
Lire aussi : notre portrait du père Damien, seul prêtre volontaire sur l’Île hawaïenne de Molokaï, le ghetto des lépreux.
Le Zéphyr : Quand naissent les premiers clubs de surf hawaïens ?
Dans les années 1910, on relève deux clubs du surf à Hawaï. L’un est l’Outrigger Canoe Club et le second Hui Nalu. Déjà, il y avait des compétitions annuelles amicales entre ces deux clubs, afin de mesurer la performance des différents athlètes. Puis vient le temps de la première compétition internationale…
C’est quand ?
En 1954, à Makaha sur l’île d’O’ahu. Le Makaha International est considéré comme la plus sérieuse compétition internationale dans les années 1950, car il y a des surfeurs qui viennent de nombreux pays : des États-Unis, du Pérou, d’Australie, et de France par exemple. C’est un succès fou. Les participants reçoivent des cadeaux, mais pas ou peu d’argent. C’est arrivé que l’on offre un cochon vivant, et des ananas aux vainqueurs. Les photos sur le podium sont assez hilarantes. Cela dure jusqu’à 1971.
Deux personnes se disent alors : il faut professionnaliser ce sport. Fred Hemmings et Randy Rarick ont été remarqués au Makaha, et veulent, après leur carrière respective, entretenir le plaisir du surfeur, tout en tirant un revenu. À deux, ils vont créer une institution à Hawaï, l’IPS (l’International professional surfers), en 1976. C’est une organisation internationale ayant pour but d’organiser le circuit mondial de surf, avec une dernière étape à Hawaï. Des représentants de tous les pays viennent y participer.
C’est le début d’un circuit mondial : il va y avoir 7, 8, 9, 10, 11, puis 12 compétitions par an, et cela devient un vrai circuit itinérant pour les compétiteurs. Cela marche par inscription libre ou par invitation. Le principe : lors d’un tournoi, on gagne des points (en fonction de sa performance) et, à la fin de l’année, on voit qui gagne en additionnant les points collectés par chaque individu.
Qui a été le premier grand champion ?
Peter Townend, que je connais. Il m’envoie quelques éléments à publier pour Surfblurb. Peter n’a gagné aucune compétition du circuit mondial en 1976, mais se hissait souvent à la 2e ou 3e place à chaque fois. Résultat : il est devenu champion du monde par accumulation de points. Cela a créé une controverse, et certains de ses rivaux remettaient en cause la légitimité du titre. Comme d’autres, Peter ne participe pas à tous les tournois. Cela coûte cher de parcourir le monde. Donc, la plupart des athlètes se rendent à une bonne moitié d’événements par an. Ce n’est pas toujours suffisant pour gagner, mais parfois il y a des surprises.
Quelle est la première grosse évolution de ce tournoi international ?
L’arrivée de sponsors qui n’ont rien à voir avec le surf a été déterminante. On note par exemple de grandes marques de boisson alcoolisée, des entreprises pétrolières, ou de cigarettes dans les années 60. Avant, c’étaient de petits marchands locaux de planches et des clubs qui sponsorisaient. Là, ce sont de gros soutiens, et c’est presque étrange de voir des entreprises d’alcool et de géants de tabac sponsoriser un sport de glisse.
Quel est le contexte ?
À ce moment-là, les premiers athlètes deviennent organisateurs des tournois, et les premiers débats voient le jour : combien donne-t-on aux surfeurs ? Comment partage-t-on le gâteau entre les organisateurs et les athlètes ? Les organisateurs de l’IPS ayant été accusés de ne pas redistribuer assez aux athlètes, l’organisation a été remplacée par l’ASP (Association of surfing professionals) qui est récemment devenue la WSL (World surf league). Ici, la solution n’était pas de moins rémunérer les organisateurs, mais de faire rentrer plus d’argent pour les athlètes grâce aux partenariats.
Qu’est-ce qui change avec cette nouvelle structure ?
Les nouveaux organisateurs ont commencé à payer plus les athlètes, avec davantage de marketing et de sponsors. L’ASP est une organisation internationale fondée par des Australiens, et dont certains habitent en Californie. On note également un réel changement sur la pratique en elle-même. Par exemple, on ne valorise plus la longueur de la glisse, mais la technique. Au début, il y avait 4 ou 5 personnes dans le jury qui regardent 25 personnes à l’eau. Désormais, les compétiteurs sont 2 ou 4 à se mesurer les uns contre les autres lors d’une manche.

Les cheveux qui tombent sur les épaules, quel cliché !
La professionnalisation choque-t-elle certains ?
Pour certains, le surf est un mode de vie, ce n’est pas un sport que l’on monétise, puisqu’au départ cela ne l’était pas. Parmi les arguments évoqués, il y a celui d’un risque de perdre le côté récréatif. Pour les médias, il y a eu une scission un peu caricaturale dans les années 70 dans le monde du surf. D’un côté, on retrouve les professionnels et de l’autre les amateurs qui surfent pour l’esprit et les convictions.
Ce deuxième penchant s’appelle le soul surfing, c’est-à-dire pratiquer pour la beauté de la chose et non pour gagner de l’argent. Ensuite, il y a un espace d’entre-deux chez les athlètes amateurs. Ces surfeurs participent à des tournois sans trop gagner d’argent et le font pour le plaisir de la compétition ou la notoriété. Souvent, le monde amateur est le lieu de recrutement du monde professionnel.
Mais ils font comment pour vivre ? Ils ont un métier ?
En amateur, les sponsors financent l’équipement, fournissent l’habillement et peuvent parfois nourrir le sportif. Mais ils ne les rémunèrent pas, ou peu. Donc : oui, un amateur a un métier à côté de sa passion.

Bon, tu as encore des questions ? J’ai des vagues à aller chercher !
On parle de mode de vie de surfeur. C’est quoi ?
Là, on touche au sentimental, c’est ce qui règle ta vie. Qu’est-ce qu’un mode de vie ? C’est une manière, un style de vie. Quand tu rentres dans le surf et que tu comprends cette pratique comme un mode de vie, tu n’en sors plus. Jeune, au lieu de jouer aux jeux vidéo, tu vas à la mer, cela rythme ta vie. Tout est tourné autour du surf. Les vagues organisent ta vie. C’est simple, s’il n’y a pas de houle ni de vague, tu ne surfes pas. À l’inverse, s’il y a de la houle et des vagues, tu organises ta journée pour faire en sorte que tu puisses surfer.
Tout est une question de priorité. Surfer chamboule le travail et l‘emploi du temps, car la vie d’un surfeur s’organise en fonction des rythmes marins. C’est rare, mais il existe des entreprises dans lesquelles les employés peuvent arriver en retard le matin s’il y a des vagues. Un surfeur n’a pas le même rythme qu’un autre individu. Il suit le rythme des océans.
Il se lève plus tôt vers 4 ou 5 heures du matin pour surfer dans de meilleures conditions, ce qui implique que le soir, il se couche plus tôt aussi. Le matin… avant le boulot, c’est un moment privilégié pour surfer. Alors, oui, cela implique des sacrifices, mais c’est la raison pour laquelle cela s’appelle un mode de vie. C’est donner un sens à sa vie.
C’est quoi la différence entre un surfeur et quelqu’un qui surfe ?
Il y a des gens pour qui le surf est affaire de famille. Certains grandissent avec des parents investis dans l’industrie du surf. Pour ces personnes, le surf c’est leur histoire (vivre au bord de mer, surfer le matin, travailler dans une entreprise familiale qui est concernée de près ou de loin par le sport).
En comparaison, celui qui surfe, sans être surfeur, c’est celui qui surfe de temps en temps sans être investi d’une manière familiale ni professionnelle dans le sport. Pour mon cas, venant de Paris, je suis d’abord quelqu’un qui surfe plus qu’un surfeur. Mais depuis que je travaille quotidiennement dans l’industrie de la glisse avec Surfblurb et que j’ai effectué deux années et demi de recherche en Californie et à Hawaï, mon statut évolue un peu.
Toi, tu aurais voulu être juste surfeur ?
Qui ne voudrait pas être rémunéré pour vivre de sa passion ? Oui, cela ne m’aurait pas déplu, mais je suis déjà heureux dans ce que je fais.
Quelles sont les images du surfeur et comment ont-elles évolué ?
D’une manière très stéréotypée, un surfeur, c’est un mec cool, un séducteur ou un chômeur. Par exemple, dans les années 60, les membres du groupe de musique les Beach Boys ne surfent pas, mais utilisent l’image du surf comme support promotionnel. Le surf, c’est une image positive dans l’univers de la communication.
On parle de la Beach culture : du surf et du soleil pour valoriser une entreprise et des marques. Cette image se renforce dans les années 80 et est aujourd’hui généralisée. L’intérêt dans la chose est que cette image dure depuis tout ce temps sans s’essouffler, sans que les consommateurs s’en lassent trop.
Et pourquoi le surfeur serait-il un clochard ?
C’est l’idée que le surfeur ne pense qu’à surfer. Il ne ferait que ça, et ne penserait pas à travailler. Bien évidemment c’est un sens commun, car 99 % des surfeurs sont aussi travailleurs que tout le monde. Mais il y a un mode de vie particulier parfois. En Bretagne, à La Torche, dans le Finistère, j’ai vu une fois ce type de personne. Ce n’est pas un clochard, mais une personne itinérante. Il a un van et il vit là. Il dort sur le parking de la plage. Dans les années 1950-60, c’est ce qu’on appelle le beach bum. L’idée que la vie d’une personne est organisée autour du surf, au détriment de tout le reste.
Il arrive à subvenir à ses besoins ?
Cette vie-là nécessite un équilibre fragile. Il faut gagner beaucoup d’argent lors d’une saison en tant que moniteur ou autre, puis ensuite il faut accepter de tout dépenser pendant une autre saison, avant de revenir au travail. Il y a aussi la solution des petits boulots entre temps.
Le surfeur est écolo ?
Oui et non. La plupart veulent un océan propre. Mais quand il pleut par exemple, les surfeurs, comme d’autres personnes de la mer, ont remarqué qu’il y a beaucoup plus d’écoulements de déchets dans l’océan qu’à l’accoutumée. Quand un surfeur se rend dans une eau dégradée à cause d’une pluie intense, il peut tomber malade, et souffrir au niveau des yeux, des oreilles, et de la bouche. C’est pénible. Certains agissent et participent à des campagnes de sensibilisation que cela soit d’une manière individuelle et indépendante ou dans une association.
Mais qu’on s’entende bien, ce ne sont pas tous les surfeurs qui font cela. Ceux qui adoptent une attitude écologique, ce sont ceux qui ont non seulement la conviction, mais aussi le temps de le faire. Car c’est un temps non consacré au travail, et donc un temps non rémunéré. Seule une minorité de surfeurs s’y mettent sérieusement.
Actuellement, qui sont les meilleurs surfeurs ?
Il y en a beaucoup. Pour n’en citer que quelques uns, on retiendra du circuit professionnel le Brésilien Adriano de Souza, et l’Australien Mick Fanning. Je pense également à l’Américain Kelly Slater qui est le plus impressionnant par sa longévité. Cela fait plus de 20 ans qu’il est dans le monde professionnel, et il a gagné 11 titres internationaux, c’est un record.
À 45 ans, il est encore là, dans le circuit, c’est un athlète hors-norme qui vient de Floride, il a tourné quelques scènes dans Alerte à Malibu. En France on retiendra Jérémy Flores. À noter que Bixente Lizarazu, l’ancien footballeur professionnel, est un surfeur connu également.
Vous en êtes à l’épisode 2.
Lire l’épisode 1
Lire l’épisode 3
Propos recueillis par Philippe Lesaffre