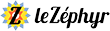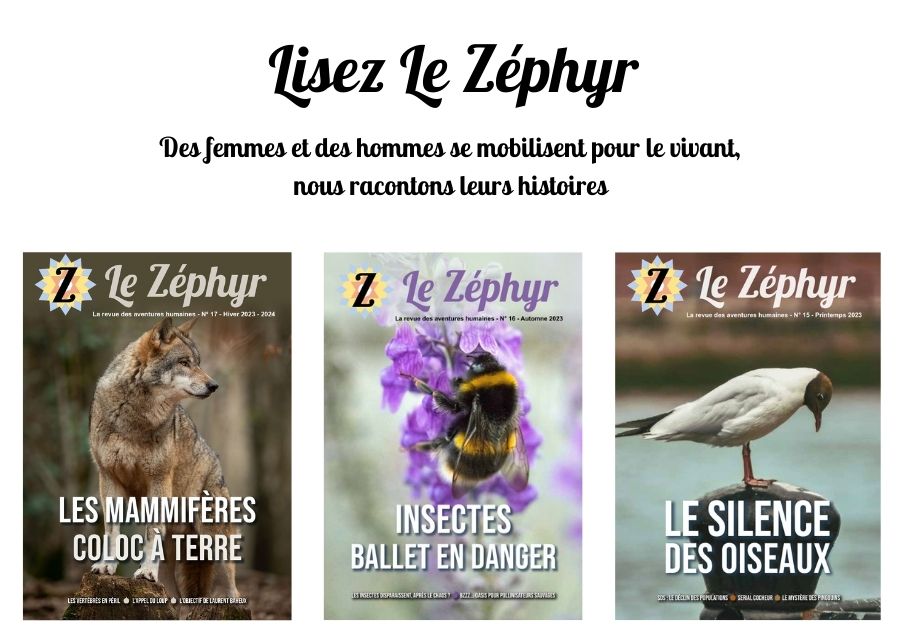Quelques jours avant la Journée internationale du castor, organisée le 7 avril, nous avons échangé avec l’historien Rémi Luglia, président de la Société nationale de protection de la nature (SNPN). Depuis longtemps, il défend les castors européens, des « ingénieurs », capables de transformer les paysages le bord des cours d’eau.
Le Zéphyr : La Société nationale de protection de la nature (SNPN), aux côtés de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), de l’Office français de la biodiversité (OFB) et du Comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement (CDPNE 41), a lancé en 2024 l’année du castor, qui se poursuit jusqu’à l’été 2025. Pour quels objectifs ?
Rémi Luglia : Il s’agit d’abord de célébrer un anniversaire, les 50 ans de la réintroduction du castor dans le bassin de la Loire. Le mammifère avait disparu de la région au 16e siècle. Or, en 1974, des jeunes naturalistes du Loir-et-Cher ont lâché 13 individus à Blois. L’opération a été une réussite. Les castors ont su se réapproprier l’ensemble du bassin, de Nantes, en amont, à Saint-Étienne, en aval. Le milieu leur était favorable, au vu de la présence d’îles ou de talus le long du fleuve et de ses affluents.
C’est aussi l’occasion de célébrer les qualités du castor, qui permet d’améliorer son environnement, les écosystèmes, au bénéfice tant de la biodiversité que des humains.
Lire aussi : Où se cache l’outarde canepetière ?
« Beaucoup ignorent que le castor européen vit en France »
La SNPN vise à « réhabiliter le castor dans l’imaginaire collectif ». Quelle place a-t-il ?
Il est important de rappeler que le castor européen existe en France, beaucoup l’ignorent encore. Ensuite, il convient de mettre en lumière ses qualités d’ingénieur, ce que l’animal est capable d’entreprendre en matière de travaux, de barrage, de bûcheronnage. C’est notre voisin, et il peut – au même titre que les humains – façonner les cours d’eau et ainsi notre environnement. Sensibiliser est essentiel, dans la mesure où l’ignorance est le support de tensions.
C’est-à-dire ?
Le castor abat des arbres pour consommer l’écorce et les feuilles. Il utilise les ressources pour ses constructions. Cela ne présente aucun problème pour les saules qui poussent naturellement au bord de la Loire, mais lorsque les arbres abattus font partie des zones de cultures, l’exploitant agricole peut subir quelques dégâts. La plupart du temps, ceux-ci sont limités, mais il arrive tout de même qu’ils soient plus importants. Il faut accompagner les personnes concernées, qui ne devraient pas avoir à assumer seules les coûts.
En second lieu, le castor construit des barrages pour sa famille, pour que les membres soient en sécurité et bénéficient d’eau en permanence. Ses constructions peuvent cependant inonder une partie d’une prairie, d’un champ, d’un chemin. Il convient de trouver un compromis entre les besoins du castor et les humains. Il faut l’accepter en tant que voisin et parvenir à cohabiter.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
« Grâce au castor, il y a plus de zones humides »
Les bénéfices restent tout de même importants. Depuis son retour dans le bassin de la Loire, les castors ont modifié le paysage autour des cours d’eau…
Il transforme le paysage, en effet, et les humains tirent bénéfice de la nature. Le castor conçoit une mosaïque de paysages. En consommant certains arbres, il crée des éclaircies, ce qui est positif pour les autres animaux. Il y a dans ces zones de lumière, plus ouvertes, plus d’espèces et un plus grand nombre d’individus. La biodiversité se porte ainsi mieux.
Ensuite, il y a, grâce au castor, plus de zones humides. Ce sont des éponges en cas de crues, et elles restituent de l’eau en cas d’épisodes de sécheresse. Les castors augmentent la production végétale, qui capte les nutriments (le phosphate et l’azote, présents en raison de l’usage d’engrais agricoles) et filtre l’eau. Tout cela est validé par des études scientifiques.
Souvent, il faut justifier la protection du vivant, évoquer l’intérêt que nous avons à défendre tel ou tel animal. Il faut que ce soit « utile » et que ça rapporte à la société…
Matérialistes, les humains regardent l’intérêt à court terme et non à long terme. Il s’agit de changer de perspective et de ne pas se focaliser sur les intérêts particuliers des uns et des autres. Ceci dit, le castor apporte vraiment des bénéfices. Il nous permet de mieux subir les épisodes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les épisodes de sécheresse. Grâce à lui, les besoins en irrigation diminuent. Les terrains sont plus fertiles. Il faut regarder tous ces services au long cours.
Comment le castor se comporte-t-il avec ses congénères et les autres espèces ?
C’est un animal territorial. Tous les deux kilomètres, on trouve une famille de 4 à 6 individus, les parents ainsi que les deux jeunes de l’année, voire ceux de l’année précédente. Il n’y a jamais de surpopulation, les castors ne prolifèrent pas… Au bout de 2 à 4 ans, les juvéniles prennent leur indépendance et se cherchent leur propre territoire. Ils tolèrent la présence des autres animaux.
Comme ils sont imposants et pèsent de 25 à 30 kg, en principe les ragondins ou les renards ne viennent pas les titiller. Les castors aiment leur tranquillité, mais peuvent tout de même chasser quiconque viendrait consommer trop de végétaux sur leur territoire. Ils tolèrent le passage des autres castors. Ces derniers peuvent rester de deux à trois jours, mais guère plus. Les castors connaissent par cœur leur territoire et savent si certains individus cherchent à s’y installer. Ils laissent des marquages au sol et y déposent des odeurs (spécifiques à chaque famille).
« Des familles de castors ont trouvé un refuge en ville »
Pourquoi les castors ont-ils disparu au 16e siècle ?
Ce n’est pas la modification de son habitat naturel qui a abouti à leur disparition, mais la chasse. Celle-ci a provoqué une phase de régression très importante au cours du 16e siècle. On n’a pas de date précise. En 1909, la chasse a été interdite, c’est – jusqu’à preuve du contraire – la première espèce à avoir bénéficié d’une mesure de protection.
Et aujourd’hui, le castor recolonise nombre de territoires, depuis le Sud-Est…
Le castor n’a jamais disparu du bassin du Rhône. Après la réglementation en 1909, il a pu investir de nouvelles zones, tant naturellement que via des programmes de réintroduction. Il y en a eu 27 au niveau national, par exemple à Blois en 1974 ou au sein du département de la Loire en 1994, pour aider le castor à contourner un barrage hydroélectrique dans la plaine du Forez.
Désormais, on découvre des castors tout au long du Tarn, de la Garonne, du Rhin, de la Moselle, de la Seine. Les castors progressent vers le nord. Comme il s’adapte, on en retrouve, y compris en ville. Je connais des familles de castors à Tours, à Orléans, à Lyon. Les individus arrivent à vivre avec des lampadaires qui éclairent la nuit, et malgré le bruit des voitures. Ils s’en accommodent assez bien.
Quand on laisse l’animal tranquille, cela se passe bien…
Il suffit d’arrêter de le détruire et de lui laisser de la place. La biodiversité se remet des désagréments des activités humaines, la nature se régénère et c’est bénéfique pour la biodiversité et les humains. On a tout à gagner à laisser de l’espace à la faune sauvage et plus spécifiquement au castor. Il faut se réconcilier avec le vivant et mieux considérer les êtres vivants. / Propos recueillis par Philippe Lesaffre