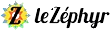Dans le métro, Mira regarde une pub du jeu vidéo Call of Duty. Elle qui a vécu la guerre, en Syrie, veut comprendre comment on peut la trouver si divertissante.
Au hasard des couloirs d’une station impersonnelle, le regard se perd, vagabonde et finit par se poser sur une affiche. Immense, démesurée même, elle vante les qualités d’un énième jeu vidéo développé sur une console de salon. On nous promet l’aventure, les exploits, le grand frisson. Étalée sur des dizaines de mètres carrés au beau milieu de la gare Saint-Lazare, à Paris, la monumentale publicité dédiée au dernier Call of Duty est un hommage au culte des armes et de ses héros.
À quelques mètres des escaliers, une jeune femme guette, adossée à un pilier grisâtre. Elle tend la main face à une foule trop pressée pour l’apercevoir. Elle est accompagnée de quelques proches, eux-mêmes naufragés d’un monde devenu cannibale.
Lire aussi : notre portrait de Matthew Cassel, reporter aux côtés de migrants syriens
Elle s’appelle Mira et m’explique qu’elle vient d’Alep. Dans son regard comme dans sa gestuelle, tout traduit le quotidien exténuant, la longue route qu’il a fallu prendre, les risques qu’elle a affrontés et, caché derrière un léger sourire de politesse, la détresse d’avoir perdu tant de monde. « Les biens, c’est une chose. Ça se remplace. Mais j’ai perdu huit membres de ma famille dans les bombardements de Bachar », me dit-elle dans un anglais bredouillant. À ses côtés, un jeune garçon d’à peine six ans, joue avec une petite voiture. Elle m’explique que c’est son fils. Pour le protéger, ils ne restent jamais très longtemps au même endroit. La gare grouille de policiers en civil et d’agents de la RATP. Elle ne veut pas attirer leur attention.

Une affiche démesurée
Comme beaucoup de monde, elle a repéré l’affiche gigantesque qui lui fait face depuis qu’elle s’est installée dans ce couloir glacial. Elle déchiffre le titre du jeu, comprend qu’il s’agit d’un « appel du devoir » et que cela concerne la guerre ; celle que l’on va chercher. Mira n’a pas trente ans, mais pourrait écrire des livres entiers sur la condition humaine. Dans son pays, elle élevait ses enfants. Ça lui suffisait tout à fait. La guerre a frappé durement.
« Sans même qu’on puisse réagir, nous étions bombardés. Les maisons et les bâtiments s’effondraient autour de nous. Très vite, on n’a plus été en mesure de dénombrer nos morts. Nous ne représentions pourtant rien pour le régime. Nous n’avions ni armes ni munitions. Nous étions des civils pris dans une ville symbolique », s’est-elle souvenue. En l’espace de six ans, 465 000 personnes sont mortes dans cette ville, soit plus que la population totale d’une ville comme Toulouse.
Les autres, les derniers, ont quitté les lieux du massacre pour gagner un hypothétique exil. Mira a parcouru des centaines de kilomètres à pied avec son jeune fils. Traversant les frontières et les reliefs, se jouant de la vigilance des gardes et des policiers, elle a fini par échouer à Paris.
___________________________________________________________________________<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
___________________________________________________________________________
Partir loin, très loin
Hicham, le mari de Mira, n’a pas pu sauver ses filles. Elles sont restées ensevelies sous les décombres d’un bâtiment. Elles avaient 8 et 4 ans. Elles étaient, selon leur mère, belles et fortes comme leur père : « Ça l’a anéanti. Après que cet obus s’est écrasé dans notre salon, rien n’a plus été pareil. » En quelques mots, elle me fait comprendre que les corps n’ont jamais pu être extraits, qu’il a fallu fuir sans se retourner, avec le petit dernier sous le bras. Pleurer ? On verrait plus tard. Pour l’heure, il fallait partir loin et ne jamais revenir. « Dans les jeux vidéo comme ce « colofdouty » (sic), on ne se pose pas de questions. On tue, on évite les bombes et les ennemis. On gagne des trophées au nombre de morts. Ça paraît facile et sans doute très gratifiant. Mais la guerre, ce n’est pas ça », prévient-elle en montrant l’affiche du doigt.
L’écrivain Michel Del Castillo disait que « dans une guerre il n’y a ni vainqueurs ni vaincus: il n’y a que des victimes ». Ce n’est sans doute pas totalement vrai. Il reste ceux qui appuient sur un bouton, sans se poser de questions. « Nous ne sommes vraiment pas du même pays », lance-t-elle subitement avant d’ajouter qu’elle voit bien « les regards suspicieux, les gros titres, ce qu’on reproche aux migrants. Mais je peux jurer sur le Coran que personne, chez moi, n’irait jouer à la guerre comme ça. Le prix du sang, on le connaît trop bien pour s’en amuser ».

Une voiture, sans adieu
Avant de reprendre ses sacs et son fils sous le bras, elle prend le temps de m’expliquer ce qu’il est advenu d’Hicham. Un jour, près de la frontière jordanienne, un groupe de rebelles les a arrêtés. Jusque-là, tout se passait normalement. Ils allaient passer de l’autre côté et s’enfuir enfin de cet enfer. C’était sans compter la suspicion omniprésente qui régnait en ces lieux maudits pour toujours. L’un des hommes ayant mis Hicham en joue, il expliqua que le mari de Mira avait l’air bizarre. On pensait alors qu’il pourrait s’agir d’un agent d’Assad déguisé en civil pour se fondre dans le décor.
Lire aussi : Khaled Barakeh : artiste ou activiste ?
En deux minutes, Hicham a été emmené dans un véhicule et n’a plus jamais redonné signe de vie. Malgré ses protestations et les hurlements de son fils, la voiture s’est éloignée, laissant la mère et l’enfant seuls dans cette zone désertique. « Comme les hommes de Bachar, ces rebelles se sont accrochés à l’idée qu’ils faisaient leur devoir, qu’ils avaient répondu à ce fameux appel du devoir », dit-elle pour conclure. Une annonce au micro, quelques mots dits en français et qu’elle ne pouvait comprendre… C’était le signal du départ pour elle. Mira ne veut pas finir dans un centre de rétention. Elle préfère fuir, toujours plus loin, vers un ailleurs qui se dérobe sous ses pas comme s’était dérobé le sol de son appartement d’Alep au moment des bombardements. / Jérémy Felkowski