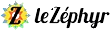En Hongrie, on le surnomme « le dernier samouraï de Pecs ». Né à Tokyo, Kimiyoshi Suzuki s’est expatrié, par amour, vers l’Europe. Il nous dévoile son univers.
Dans le gymnase de l’école-collège-lycée Valéria Koch transformé en dojo, le tintement du rin (gong bouddhiste) annonce le début d’une leçon particulière. Comme tous les mardis et jeudis, Kimiyoshi Suzuki s’apprête à dispenser à une douzaine d’apprentis les préceptes du kenjutsu, l’ancêtre du kendo signifiant littéralement « art du sabre des samouraïs ». Le salut rituel accompli, les élèves s’échauffent épée en bois à la main avant d’entamer une série de combats d’entraînement ponctués de cris rageurs. Les dagues en chêne s’entrechoquent et les « haï » (oui en VF) répondent aux instructions du moniteur.»
Au milieu des Gyula et Gergő écoutant religieusement les conseils de Suzuki sensei (maître), les noms à consonance nippone sont plutôt rares à Pécs en dehors des quelques étudiants japonais investissant épisodiquement la célèbre université locale. Kimiyoshi a allègrement dépassé l’âge des amphis et porte fièrement ses 83 printemps que personne ne lui donnerait, tant l’homme est redoutable en kimono. Une témérité qu’il tire de son grand-père, jeune guerrier à peine trentenaire lors de la rébellion de Satsuma, ultime baroud d’honneur des samouraïs maté par les troupes impériales en septembre 1877.

Avec ses élèves
Douaniers zélés et chambres noires
Kimiyoshi est tombé amoureux de la Hongrie au seuil de la soixantaine en même temps que de Katalin, une Magyare dont il partage la vie depuis un quart de siècle. L’intégration n’a pas été une mince affaire. « La première fois que je suis venu à Budapest, les douaniers de l’aéroport m’ont pris pour un criminel. Ils se demandaient ce qu’un Japonais cherchait dans ce pays toujours sous régime soviétique en 1986. J’ai été invité par des amis photographes magyars qui voulaient à tout prix me faire découvrir Budapest. L’année d’après, nous avons visité Pécs et c’est là que j’ai rencontré mon épouse », raconte le Tokyoïte.
Fils d’un éminent photographe expatrié à New-York et rentré au Japon à cause de la Grande Dépression, Kimiyoshi a suivi ses traces jusqu’à la retraite. D’abord photo-reporter pour des quotidiens locaux, puis dirigeant de l’atelier paternel avec son frère lorsque le patriarche leur céda la boutique. La modeste structure d’antan est devenue le réseau de magasins spécialisés le plus important du pays. Mais l’esprit samouraï familial s’est ancré bien avant les chambres noires dans le cortex de Kimiyoshi. Le natif de 1934 s’est frotté aux arts martiaux (judo, kendo) dès l’école primaire sans jamais s’arrêter.
Sa seule pause date de la Seconde Guerre mondiale où l’archipel du Soleil Levant capitule face aux bombes atomiques de Washington. Après la débandade, l’occupant américain force le Japon à renoncer aux conflits armés et réquisitionne les arsenaux. Suzuki senior parvient à dissimuler deux katanas conservés par son guerrier de père qu’il lègue à ses enfants. Kimiyoshi hérite d’une lame tricentenaire de 60 centimètres qui vaudrait environ 7500 euros si elle était soumise aux enchères. « Pas question de la céder au plus offrant. C’est un trésor inestimable ! », balaie cash son propriétaire.

« Avec lui, on s’élève spirituellement »
Le samouraï de Pécs dévoile la merveille rutilante dans son dojo privé traversant l’entresol de sa villa nichée au pied des Mecsek. Les sommets du massif environnant rappellent quelque peu l’île pentue d’Hokkaïdo où son grand-père dut fuir avec ses camarades d’infortune défaits par les loyalistes. « Mon illustre ancêtre et mon ancien grand maître Gogen Yamaguchi (icône du goju-ryu, dérivé du karaté, ndlr) veillent sur moi avec bienveillance. Yamaguchi sensei m’a forgé et grand-père est si respecté à Acuta, où il a créé sa propre école, que le village a érigé un obélisque à son effigie », raconte Kimiyoshi.
Si Maître Suzuki n’est pas du genre à chercher les honneurs, il aime transmettre son art à son prochain. Tout juste installé en Hongrie (1992), Kimiyoshi profita d’un salon consacré au Japon à Pécs pour populariser son univers via une démonstration organisée avec trois compatriotes. Résultat, les garçons du voisinage se précipitèrent aux cours balbutiants à domicile. Ce succès fulgurant déboucha sur l’ouverture du dojo Shinbukan axé gojo-ryu dès 1993 et l’ajout de l’enseignement du kenjutsu (1998). L’octogénaire distille désormais son savoir entre son fief Pécs, Budapest, l’Allemagne et la Slovaquie.
« J’ai toujours adoré les confrontations à l’épée, les films épiques dans la veine des Sept Samouraïs (Akira Kurozawa, 1954, ndlr). Je fréquente assidûment les cours du maître depuis 18-20 ans facile », témoigne l’expérimenté Ákos, professeur d’EPS auréolé d’un 2e dan en kenjutsu. « Au-delà du maniement de l’arme, le maître nous apprend le contrôle de la respiration, l’importance de la concentration et les vertus du travail collectif. Avec lui, on s’élève spirituellement. Suzuki sensei pète la forme malgré son âge avancé. Un monsieur fascinant et humain. Presque trop humain », dit le disciple.
Kimiyoshi prend aussi soin de rentrer une fois par an dans son Japon lointain qui lui manque souvent. Chaque matin, il épluche l’actualité nippone sur son PC de bureau en dégustant son muesli. D’ailleurs, côté nourriture, le samouraï filiforme apprécie moyennement l’hyper-lourde gastronomie magyare. Aux goulash et autres pörkölt (ragoûts) baignant dans un précipité oignon-paprika-huile, il préfère un diététique riz-légumes assorti d’à peine quelques morceaux de porc sélectionnés par Madame Suzuki. Katalin se fournit au seul magasin oriental de la ville afin de japaniser au mieux l’assiette de son époux.

Suis-je beau ?
Camps d’été et Tom Cruise
Suzuki sensei n’a jamais conçu son art comme un gagne-pain et n’a jamais demandé un centime à ses adeptes. Il vit plus que confortablement grâce à sa pension japonaise et n’a guère besoin de complément. Ses apprentis se cotisent en revanche histoire de payer la location annuelle de la salle d’entraînement. La somme collectée dépasse généralement le tarif demandé. Le rab’ couvre l’organisation de camps d’été mettant en exergue la culture samouraï ainsi qu’une partie de certains voyages professionnels du maître, comme cette escapade berlinoise qui l’attendait durant la semaine suivant notre rencontre.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
« Kimiyoshi a une modestie et une droiture profondément ancrées en lui », confie sa chère et tendre. « Il a trimé toute sa vie pour être celui qu’il est devenu et explique à tous ceux s’intéressant à son parcours combien ses aïeuls ont guidé sa philosophie. Il a eu beaucoup de difficultés à s’adapter au début, mais les gens le considèrent comme un vrai Hongrois aujourd’hui. Ses fautes de magyar ne l’ont jamais desservi. Il s’est habitué au débit de ma voix et sait parfaitement se faire comprendre même s’il bute assez souvent. De toute façon, Kimiyoshi suscite la sympathie sans avoir à parler énormément. »
La sympathie… et un respect naturel. Car quand Suzuki recadre, ses ouailles s’exécutent sans broncher. Etre le seul 6e dan en kenjtusu de toute la Hongrie et avoir un grand-père héros de guerre ayant inspiré la trame du film-fresque Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, ça vous pose un homme. Son katana survit aux ravages du temps grâce à un forgeron chouchoutant le bijou du côté de Káposvár. La précieuse épée conçue à la fin du XVIIe siècle s’appelle « wakizashi ». Sa lame moins épaisse et plus courte qu’un sabre lambda facilite l’entretien, même si d’infimes tâches de rouille trahissent son âge.

« Canaliser sa colère »
Malgré ses 83 printemps, maître Suzuki n’est pas submergé par la modernité et manipule aisément sa tablette comme n’importe quel rejeton de la génération Y. Son unique critique un tantinet « réac’ » ? L’occidentalisation des gamins nippons qui crient ou réclament comme n’importe quel européen gâté. Enfant de la montée des périls et de 1939-45, Kimiyoshi a vécu les privations et craint pour son existence. Existence meurtrie par la perte précoce de sa première épouse, musicienne décédée en janvier 1985. Sa résilience façonnée au gré des combats lui a permis d’encaisser ce deuil soudain et d’aller de l’avant.
« Le meilleur samouraï est celui qui ne porte pas de sabre », tranche Kimiyoshi, le sourire aux lèvres. « C’est une question d’humilité et d’état d’esprit. Le kimono est sale à l’intérieur, propre à l’extérieur. On peut hurler contre son adversaire, mais, en vérité, on affronte une version fantasmée de soi-même. Il faut savoir canaliser sa colère. Dans la rue comme sur les tatamis, celle-ci est forcément mauvaise conseillère. Les duels d’autrefois n’avaient que deux issues : la victoire ou la mort. Aujourd’hui, être samouraï, ce n’est pas lutter pour sa survie mais se réaliser en tant qu’humain et comprendre autrui. »
Lire aussi : le portrait du frère chinois de Jésus qui inspira les révolutionnaires communistes.
Tandis qu’il développe sa vision de l’Homme, une puissante bise claque sur les contreforts des Mecsek. Kimiyoshi n’est guère troublé par l’orage de neige fondue s’étant abattu la veille sur sa Pécs de coeur. Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, pas question de laisser tomber le rituel du mardi et du jeudi. Préparation du paquetage, descente en voiture, salut aux élèves, exercices et fous rires en cascade. Quiconque ose lui demander quand sonnera la quille recevra un « jamais » déterminé en pleine face. Le petit-fils de l’iconique Makita Shigekatsu attend son ultime souffle pour déposer les armes. Serein. /Joel Le Pavous