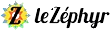Après un long-métrage sur la masturbation féminine, Isabelle Broué se penche cette fois sur les amours plurielles. Rencontre avec une cinéaste féministe qui sait depuis longtemps que la monogamie n’est pas sa tasse de thé.
Dans Lutine, en salles depuis début avril, Isabelle Broué, cinéaste, aux allures de psy, se met en scène dans son propre rôle, enfin presque : elle joue le rôle d’une réalisatrice qui souhaite écrire un film sur l’univers de la “polyamorie”, une non-monogamie éthique.
Les amours non exclusives, c’est une philosophie qu’elle a découverte sur le tard, en 2009, à l’aube de ses 40 ans. Et dont elle parle avec passion. Elle a même embarqué avec elle son compagnon. « On a combien de temps ? », demande-t-elle. Je tente une réponse, sans vraiment savoir : « Cela dépend ! » Elle rit, et glisse : « Je suis très bavarde. »
Lire aussi : le portrait du cinéaste marseillais Nawyr Haoussi Jones.
“C’était pour moi une évidence”
Pourquoi avoir voulu traiter du sujet de la polyamorie ?
C’est un sujet important pour moi. Cela a changé ma vie quand j’ai découvert que c’était possible, que des gens vivaient comme ça. Depuis toujours, on nous raconte que, quand on est en couple, il faut être exclusif.ve. Et que, si on a envie d’être avec quelqu’un d’autre, c’est forcément que l’on n’aime pas son ou sa conjoint.e. Or cela n’est pas le cas pour tout le monde. J’ai découvert la polyamorie il y a neuf ans lors de ma séparation du père de mes enfants, et cela m’a retourné la tête. Je me suis alors rendue compte que c’était pour moi une évidence, que j’avais toujours senti ce côté-là en moi : je ne vois pas en quoi le fait d’être en relation avec une personne m’empêcherait d’être en relation avec d’autres, tant que je ne fais de mal à personne, et que tout le monde est consentant. Pour moi, l’un n’empêche pas l’autre : on peut à la fois construire quelque chose de profond et de durable avec une personne, et, par ailleurs, rester ouvert·e à ce que la vie nous propose, aux désirs, aux émotions, aux sentiments divers qui peuvent naître… sans pour autant être dans le mensonge.
Vous l’avez toujours su ? Il y a eu un déclic ?
J’en ai eu l’intuition à mes 17 ans lors d’un voyage après mon bac aux États-Unis. J’étais alors en « couple » avec un garçon. Or, j’ai dû attendre mes 40 ans pour découvrir que je n’étais pas seule à avoir envie de pouvoir vivre des relations plurielles. J’ai écrit et tourné Lutine car j’avais besoin de partager, de pouvoir en parler à visage à découvert, sans me cacher, sans en avoir honte, pour aussi, transmettre, et inviter d’autres personnes à s’interroger sur ce qu’elles ont envie de vivre, pour apporter ma pierre à l’édifice et contribuer, à ma façon, à lever les tabous.

<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
___________________________________________________________________________
« Cela m’a retourné la tête »
Quel est le message que vous voulez faire passer ?
La polyamorie reste minoritaire. En parler permet d’ouvrir le débat dans la société. Dans les médias, le sujet est parfois traité de manière racoleuse – le sexe, c’est vendeur. Et souvent, il y a des associations d’idées entre polyamorie et libertinage. On se dit : elle a plusieurs relations, donc c’est une salope. Peut-être, oui, mais “éthique, la salope !” [Elle reprend, en riant, le titre du livre, écrit en 1997 par Janet Hardy et Dossie Easton, ndlr]. Je veux casser cette idée reçue. Je souhaite, à mon niveau et modestement, tenter de changer la société, libérer la parole, lever l’hypocrisie. Avec mon premier long métrage, Tout le plaisir est pour moi, qui parlait de plaisir féminin, de clitoris et de masturbation, j’invitais déjà les femmes à se prendre en main – au sens littéral du terme. (Rires.)
Le but du jeu était de pouvoir dire : oui, je suis poly et je l’assume, il n’y a rien de choquant en cela. Cela peut être dérangeant car c’est différent, mais cela n’empêche pas d’élever des enfants dans la tolérance, la bienveillance et l’écoute. Les poly – du moins en théorie – réfléchissent à leurs relations, dialoguent en communication non violente, vivent des relations basées sur le respect et la confiance.
D’ailleurs, pourquoi dites-vous polyamorie et non pas polyamour ?
“Polyamour” vient du néologisme polyamory en anglais, un mélange de grec et de latin. Les Français l’ont traduit par “polyamour”, mais c’est un faux-ami, car polyamory n’est pas polylove, et être polyamorous ne veut pas dire “être amoureux·se” de plusieurs personnes. Amorous signifie en effet : “Être attiré·e – notamment sexuellement – par quelqu’un.”

« Oui, je suis poly et je l’assume »
Les Américain·es parlent de polyamory comme d’une non-monogamie éthique et consensuelle. Or c’est aussi le cas – en théorie, toujours – du libertinage. Pour distinguer les deux termes, ils ont créé le mot polyamory en “positif” pour parler de relations plurielles dans lesquelles on peut laisser la place à des émotions, des sentiments, voire des sentiments amoureux, de se développer. La polyamory, que je francise en polyamorie est une orientation relationnelle là où le libertinage est avant tout – en tout cas, dans son acception contemporaine, notamment via l’échangisme – une pratique sexuelle. Vivre en “polyamorie”, ou être “poly”, ne veut donc pas dire obligatoirement “être amoureux·se” de plusieurs personnes en même temps, mais bien avoir la possibilité de vivre des relations plurielles, non exclusives – qu’elles soient amoureuses ou non, sexuelles ou non – dans un cadre consensuel et éthique.
Et si cela ne marche pas ? Si l’autre personne n’est pas d’accord ?
Si une personne a envie de vivre plusieurs relations en parallèle, il ou elle en parle avec la ou les personnes avec lesquelles elle est en relation, et l’ensemble des personnes concernées définissent le cadre et les modalités dans lesquelles ces relations vont pouvoir se vivre. En aucun cas, il ne s’agit d’imposer quoi que ce soit à qui que ce soit : on parle bien ici de dialogue dans une confiance mutuelle et réciproque. J’ai un ami qui est resté près de dix-huit ans avec sa compagne, dont onze après lui avoir dit qu’il avait envie de vivre des relations plurielles.
Tant qu’elle ne se sentait pas prête ou que ça ne lui correspondait pas, il a attendu. Ils ont fini par rompre, alors qu’ils s’aimaient toujours, parce qu’elle souhaitait qu’il reste exclusif, tandis que, pour lui, c’était devenu un impératif de pouvoir vivre d’autres relations. Bref, ils ont discuté, et rien n’a été imposé. Bien sûr, c’est un cas extrême, mais l’idée est que chaque personne ait le choix de vivre ce qu’elle a envie de vivre, sans que ça ne lui soit imposé de l’extérieur, qu’elle puisse décider pour elle-même de ses relations, exclusives ou non.
C’est-à-dire ?
Imposer quelque chose à une personne – qu’elle le sache ou non, d’ailleurs – c’est de l’abus, c’est ne pas respecter le désir de l’autre. Quand on trompe, on met son ou sa partenaire devant le fait accompli. C’est une rupture du contrat, ce contrat implicite qui impose encore, dans notre société, d’être exclusif·ve à partir du moment où l’on débute une relation. En tout cas, c’est compris comme cela. Au début, on est amoureux·se, l’exclusivité apparaît souvent comme une évidence. Et puis au bout de quelques mois ou quelques années, il arrive qu’on rencontre quelqu’un d’autre, et qu’on ait envie qu’il se passe quelque chose avec cette personne.
Que faire ?
Le contrat dit qu’on n’a pas le droit de faire quoi que ce soit : on est coincé·e. Soit on en parle, en prenant le risque de faire tout exploser – « Tu ne m’aimes plus, tu m’as trahi·e, je ne pourrai pas le vivre, je te quitte. » – soit on ne dit rien, car, de toute façon, on ne sait pas forcément ce dont on a envie avec cette nouvelle personne, c’est peut-être juste un crush, et cela ne vaut pas la peine de remettre en cause tout ce que l’on a construit par ailleurs.
Je connais des tas de gens qui ne font rien. Qui ont vécu des tentations, mais ont choisi de ne pas les vivre, et de ne pas même en parler, ce que je comprends – je l’ai vécu longtemps. Et il y a l’option 3 : prendre le risque de tromper. Certain·es le vivent bien, d’autres moins, ils ou elles le vivent dans la culpabilité et la peur d’être découverts·es. Ça aussi, je l’ai vécu, et je ne souhaite plus le vivre. C’est la face cachée – hypocrite – de la monogamie. Les chiffres de l’adultère sont impressionnants.
Lire aussi : Elizabeth Warren, l’anti-Trump qui vise la Maison Blanche
Une philosophie de vie
Et donc, enfin, l’option 4, la polyamorie…
Les poly se disent – et assument – que rencontrer quelqu’un peut arriver. L’idée est donc d’en parler avant, de se demander comment je réagirais, comment j’ai pu réagir autrefois, de quoi aurais-je besoin pour être rassuré·e. Il est question de dialogue et de respect des besoins de chacun·e. C’est du travail. Le film ne dit pas que c’est facile. Car, même si, pour certain·es, cela peut être facile, c’est loin d’être le cas pour tout le monde. C’est avant tout – en tout cas, pour moi – un choix éthique, une philosophie de vie.
Combien y a-t-il de « poly » en France ?
En France, on ne sait pas, car à ma connaissance, on n’a pas de chiffre. Dans les pays anglo-saxons, on parle de 5 % des personnes. Ils sont en avance par rapport à la France dans le sens où l’on sait que ça existe.
Pourquoi ?
On en parle depuis plus longtemps. C’est un mouvement qui est né à la fin des années 1990 à San Francisco, une enclave de liberté aux États-Unis. Des personnes ont créé des cercles de parole, d’expérimentation, d’échange – quand nous parlons de cafés poly, elles préfèrent le terme support groups. De nombreux livres ont été écrits, des blogs ouverts. Des États-Unis, c’est parti au Canada et en Australie qui ont accès à la littérature anglophone.
Et la littérature française ?
Quand j’ai entendu parler pour la première fois de polyamorie début 2009, il n’y avait en français que les livres de Françoise Simpère, qui parlait, elle, de lutinage et d’amours plurielles, ainsi que le site “Polyamour.info“. C’était difficile pour les personnes qui ne parlaient pas anglais d’accéder à l’information. L’édition française de The Ethical Slut aux éditions Tabou est sortie en 2013 quand je préparais Lutine.
Vous remarquez que de plus en plus de gens y viennent ?
Cela se développe depuis 4-5 ans. J’ai l’impression que c’est un phénomène européen, voire occidental : à Berlin, Vienne, Rome, Barcelone… Quand j’ai commencé à fréquenter les cafés poly, en 2009, c’était chez les un·es ou les autres, et on était une douzaine ; maintenant, on est 80-100 chaque 4e mardi du mois au café de Paris. J’ai tourné il y a quatre ans dans le lieu de notre « vrai » café poly, où on était environ une trentaine : aujourd’hui cela ne serait plus possible.
Et l’idée, c’est que le nombre de participant.e.s grimpe ?
L’idée n’est pas de faire venir toujours plus de monde aux cafés poly. Il y a le grand café poly mensuel, où l’on accueille les nouvelles personnes. Certains.es ne viennent qu’une fois, d’autres reviennent ou choisissent de fréquenter des espaces de parole différents, plus petits, comme le “mini-café poly”, ou les “salons Lutine & Cie”, que je co-anime avec mon compagnon ; d’autres préfèrent des moments de rencontre plus informels, comme les goûters, les pique-niques. Il y a de plus en plus d’événements divers, dans toute la France, et dans tous les pays occidentaux. Et même à Taïwan et en Inde, où j’ai des contacts grâce à mon film. On trouve de nombreuses communautés, les personnes se regroupent par centres d’intérêts. Ce sont des collectifs démocratiques, alternatifs sans hiérarchie.
Qui sont les participant.e.s ?
Je dirais qu’en moyenne, les participant.e.s ont entre 30 et 40 ans, mais ça va de 20 à 70 ans. J’ai l’impression qu’ils ou elles viennent plutôt de milieux socio-professionnels élevés, car vivre en polyamorie implique souvent d’avoir les moyens et le temps de travailler sur soi. C’est en général – pas toujours – un investissement de temps et d’émotion, un véritable travail.
Autant de femmes que d’hommes ?
J’ai l’impression – mais je peux me tromper – qu’il y a plus de femmes. En tout cas, plus qui le revendiquent et le portent haut.
Pourquoi ?
Je ne voudrais pas généraliser outre-mesure, mais le fait de vivre plusieurs relations en parallèle – en cachette – a malgré tout toujours été, de tout temps, un privilège d’hommes. Ils avaient moins à perdre de pratiquer l’adultère. Au pire, ils mettaient une autre femme enceinte. Une femme, elle, prenait – et prend toujours – le risque de tomber enceinte, et a peut-être plus intérêt à ce que ses relations multiples soient connues. J’ai l’impression que les hommes qui fréquentent les cafés poly sont plus éveillés, déconstruits, féministes qu’en général dans la société. Car, et c’est important de le dire, la polyamorie est nécessairement et radicalement féministe, dans la mesure où on part du principe que chacun.e des partenaires a les mêmes droits. Et ce, quel que soit son genre, son âge, son milieu socio-culturel et économique.
Et qui vient lors de vos projections ?
Les poly de Paris ont pour la plupart déjà vu le film qui a été terminé il y a deux ans et j’ai organisé des projections ici ou là, comme au ciné-club de l’École normale supérieure en novembre 2017, où on était plus de 150 ! Aux 3 Luxembourg et à l’Accattone, à Paris, depuis sa sortie en salles le 4 avril, j’ai donc plutôt l’impression que ce sont des spectateurs lambda, qui ne connaissent pas nécessairement le concept, et qui viennent voir le film parce qu’ils en ont entendu parler par la presse ou les réseaux sociaux, ou parce qu’ils ont vu la bande-annonce sur Allociné. Hier soir (la veille de l’entretien, qui a eu lieu le 14 avril, ndlr), une fille m’a dit : “Waouh, c’est donc possible de vivre comme ça. Jusqu’à maintenant, pour moi, c’était de l’ordre du fantasme…”
Que pensez-vous du mouvement Me too (à lire aussi : l’entretien de Sandrine Rousseau sur le mouvement “Me too) ?
Cette libération de la parole, c’est essentiel. Me too, c’est notre pain quotidien dans les milieux poly. J’ai organisé une conférence sur le consentement il y a un an, en y invitant notamment l’une des créatrices de la “Conférence gesticulée sur le consentement” et une psy qui travaille avec des agresseurs, et la vidéo sur le consentement et la tasse de thé se trouve sur mon blog depuis longtemps (regardez-là ci-dessous). Les cafés poly ne sont pas un lieu de drague, et l’un de mes combats est de dénoncer les relations abusives.
“Moi, j’aime bien le slow sexe”
Comment êtes-vous tombée dans le cinéma ?
Entre 12 et 16 ans, j’ai porté un corset en raison d’une double scoliose, et j’allais au cinéma plusieurs fois par semaine, et pas aux boums qu’organisaient mes camarades de classe. Je vivais par procuration, et sans doute, cela me permettait de vivre dans un monde meilleur. Aujourd’hui, j’y vais encore souvent, bien qu’un peu moins depuis que j’ai des enfants.
Qu’est-ce que le cinéma vous apporte-t-il ?
À 13 ans, je voulais être psy. Depuis toujours, l’humain et les émotions m’intéressent. Et le cinéma, c’est ma manière à moi de communiquer avec le plus grand nombre de personnes possible. En tentant, en plus, tant qu’à faire, de leur procurer du plaisir et de les faire rire. Les débats qui suivent les projections ne sont pas une concession que je ferais pour faire quelques entrées en plus, bien au contraire : ils me sont essentiels, car ils me permettent de vraiment rencontrer mon public, de me nourrir de la « vraie vie », ils me transforment, ils m’aident à grandir.
Lire aussi : Oksana Chatchko, l’icône des Femen suicidée de la société
Chaque soirée est différente, passionnante, émouvante. J’aime raconter des histoires en prenant le temps. Vous êtes un slow media ? J’aime bien, moi, le slow sexe et l’idée de travailler la société en profondeur. Marre des films kleenex qu’on regarde et qu’on oublie aussitôt, de cette société du zapping. Je veux dire « stop ». On peut se poser. Réfléchir. Et travailler ensemble pour construire un monde meilleur, plus doux à vivre, plus égalitaire, plus ouvert et plus tolérant, dans la bienveillance et le respect de l’autre et de sa différence. / Philippe Lesaffre