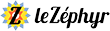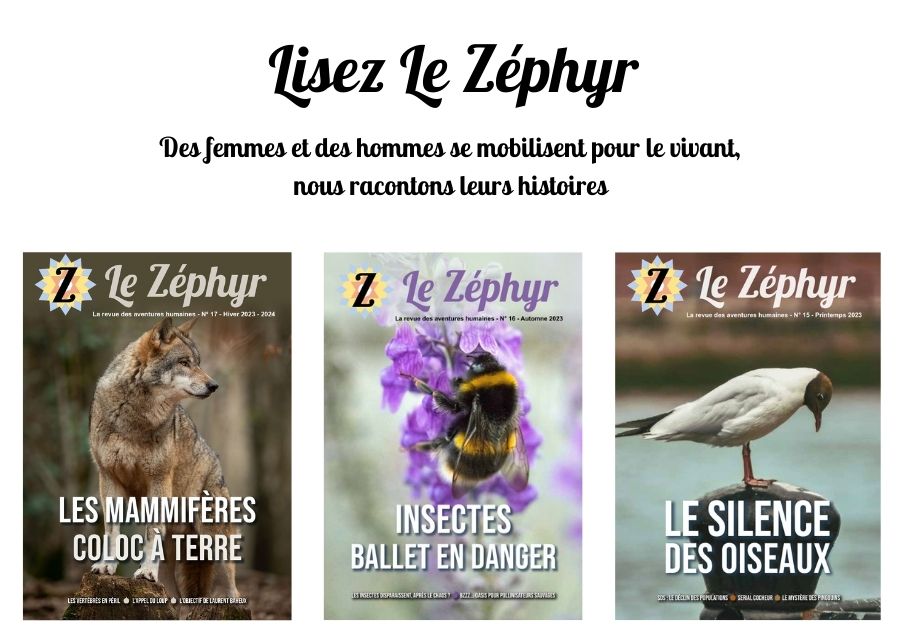Au cours d’un échange durant l’Université de la Terre, organisée les 14 et 15 mars à l’Unesco, des militants et des chercheurs ont discuté de leurs modes d’action respectifs. Comment parviennent-ils à se faire entendre dans l’optique d’obtenir des victoires citoyennes, en particulier dans la lutte en faveur de la protection du vivant ?
« Si on est vus comme les méchants, tant pis. » Invité à la vingtième édition de l’Université de la Terre à l’Unesco, Paul Watson, explique en souriant qu’il n’est pas « écoterroriste » (reprenant la célèbre formule de Gérald Darmanin) et qu’il n’a jamais « travaillé pour Mosanto ». Le fondateur de l’ONG Sea Shepherd défend vaille que vaille l’océan depuis plusieurs décennies. Afin de se faire entendre et parvenir à ses fins, il pratique avec les siens ce qu’il appelle « la non-violence agressive ». Un mode d’action visant à lutter contre les pratiques illégales de baleiniers et d’autres industriels en haute mer, à stopper leurs activités jugées néfastes – sans blesser personne – et in fine à sauvegarder les écosystèmes et la vie marine. « Les populations animales peuvent tout à fait vivre sans nous, pas les humains. Pourtant, nous les détruisons. »
« En mer c’est le Far West »
L’an dernier, le pirate qui aimerait désormais obtenir la nationalité française a été enfermé pendant plusieurs mois au Groenland. Le Japon espérait que le Danemark l’extrade dans le but de le juger ensuite. Cela n’a pas été le cas, et l’activiste a pu rentrer en France en décembre 2024. De cette captivité, il retient l’essentiel : « Mon incarcération a été l’occasion de mettre en avant les actions illégales du Japon en ce qui concerne la chasse aux baleines. » Pour lui de manière générale, c’est « c’est le Far West » au niveau de l’océan, et il faut pouvoir le raconter, le mettre en lumière.

En grand, Wolfgang Cramer @ Richard Bord, pour l’Université de la terre
C’est ce qui motive les associations de protection du vivant. « Via les vidéos que nus diffusons, analyse Brigitte Gothière, directrice de L214, on veut montrer l’envers du décor de l’élevage ultra-intensif, de poules en cage par exemple. Les images peuvent choquer, mais les informations sont toutefois bien utiles. » L’association vise à terme à « casser un système dans son ensemble », comme elle dit : « On tue les animaux sans nécessité. Or, on ne peut plus considérer les animaux, des êtres dotés de sensibilité, uniquement comme de l’alimentation. »
Lire aussi : « Le déclassement du loup ne repose sur aucune preuve scientifique »
« Les politiques nous conduisent droit dans le mur »
Les militants sont-ils trop « radicaux » ? Beaucoup répondent que non. Dans leur tête, les uns et les autres se mobilisent en tant que simples « citoyens » parce qu’ils en ont le devoir : « Les politiques nous conduisent droit dans le mur, lance Thomas Brail, fondateur du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA). Je me bats, car je veux protéger mon fils, cela me semble normal. »
Wolfgang Cramer, directeur de recherche (CNRS) à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), soutient également qu’il faut se mobiliser. Lui-même a constaté que la stratégie de pédagogie auprès des décideurs, qu’il avait soutenue dans le cadre par exemple de la COP21 en 2015 au sujet de la crise climatique, avait échoué. Et que les chercheurs pouvaient faire davantage. « Peut-être qu’on a mal communiqué en tant que scientifiques. Ainsi, je me suis senti légitime à aller plus loin. » Et ainsi à rejoindre le collectif de chercheurs Scientifiques en rébellion pour batailler contre l’inaction écologique des gouvernants. Par le passé, il avait déjà pu préciser que les blouses blanches étaient appelées à sortir des labos.
Lire aussi : « Nos canopées urbaines sont rasées » : le sixième épisode du podcast En Forêt, avec le GNSA Herblay-sur-Seine
« Il faut contraindre les décideurs »
Il n’y a pas le choix, renchérit Paul Watson, les choses ne tombent pas du ciel : « On ne peut pas attendre des pouvoirs publics qu’ils évoluent sur la façon d’habiter la Terre et qu’ils s’engagent à véritablement protéger le vivant, explique-t-il. Par exemple, si sur le droit de vote des femmes, on y est arrivés, c’est qu’on s’est mobilisés. » Typiquement, lui n’attend rien (ou pas grand-chose) de la conférence des Nations unies sur l’océan, organisée en juin prochain à Nice. « Ça discute dans ce genre d’événements, alors qu’il faudrait des actes… tout de suite. » Pour lui, « on ne peut pas juste demander aux décideurs, il s’agit de leur mettre la pression… pour qu’on arrive enfin à vivre en harmonie avec l’ensemble des espèces, humains et non-humains ».
Même son de cloche du côté de Léna Lazare, paysanne et membre des Soulèvements de la Terre : « Convaincre les pouvoirs publics de modifier leurs pratiques ne sert à rien, il faut les contraindre. » D’où les actions en justice, par exemple au sujet de projets de constructions de méga-bassines ou d’autoroutes, ainsi que les actions sur le terrain en vue de bloquer l’avancée des chantiers ou les initiatives de sabotage. « Nous voulons démanteler les infrastructures écocidaires. » Selon elle, il s’agit de « s’en prendre à la racine des problèmes. C’est d’ailleurs en ce sens que l’écologie ne peut être que… radicale ».
« Criminaliser les activistes »
Sur ce point, Wolfgang Cramer valide. Lui estime qu’un chercheur peut tout à fait « se sentir à l’aise » de critiquer l’établissement pour lequel il travaille. « Il est temps d’appeler nos établissements publics de recherche et d’enseignement, souvent porteurs de valeurs d’indépendance, à couper leurs liens avec les compagnies pétrolières et gazières. » Cela, dans la mesure où, pour limiter le réchauffement climatique à terme, il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre massivement. Le chercheur d’origine allemande admet toutefois qu’ « il est plus facile de s’engager quand on arrive en fin de carrière et que l’on occupe un poste permanent, comme (lui), que pour un jeune scientifique » à la recherche d’un emploi plus stable.
Lire aussi : Alexis Boniface, du GNSA : « On détruit des terres fertiles pour bétonner »
Quoi qu’il arrive, les risques, les militants en ont conscience. « Il y a une tendance à criminaliser les activistes environnementaux, les lanceurs d’alerte », souligne Lena Lazare. « Cette répression vise à bloquer les associations, on est sous surveillance, précise Brigitte Gothière. Par exemple, dit-elle, les procédures-baillons sont là pour nous intimider, pour censurer nos images… » Michel Forst, rapporteur spécial sur les défenseurs de l’environnement aux Nations unies, s’en était aussi inquiété et avait bien cerné le problème.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
« Pas évident de se faire entendre »
Il n’a pas toujours été aisé de s’en sortir pour des petites structures sans le sou. Réjane Sénac, l’autrice de l’ouvrage Comme si nous étions des animaux (Seuil, 2024) ou Radicales et fluides. Les mobilisations contemporaines (Presses de Sciences Po, 2021), le constate : « C’est souvent des combats entre David et Goliath. » Or, ces derniers n’en ont cure et se lancent tout de même au combat, estimant que cela en vaut la chandelle de se mobiliser contre telle ou telle inégalité ou injustice. « Ils désobéissent, mais c’est pour que la loi soit mieux respectée aussi… » Thomas Brail embraye, presque ému : « On cherche juste à ce que les arbres soient vraiment respectés. Ils sont souvent déclassés et menacés en cas de projets de construction. Alors, on s’en occupe pour nos enfants. »
Lire aussi : Chantier de l’A69 entre Castres et Toulouse : une décision « historique »
Ils se mobilisent… Pour autant, il savent bien qu’il n’est « pas évident de se faire entendre », comme l’explique Brigitte Gothière. « Il convient de faire beaucoup de bruit pour espérer intéresser les médias et les élus. » Parfois, de façon globale on mentionne davantage les modes d’action que le message en tant que tel. Typiquement quand certains militants se collent au bitume d’une voie rapide, lorsque certains jettent de la peinture sur une vitre de protection d’un tableau dans un musée ou quand d’autres crèvent les pneus d’une SUV. En tout cas, il faut faire beaucoup pour que l’opinion s’empare d’une thématique et que l’ « on parle du fond ». Thomas Brail, qui s’est lancé avec d’autres dans une grève de la faim puis de la soif (pendant un moment), peut en témoigner… Quoi qu’on pense de ce que ces hommes et ces femmes entreprennent, lui s’interroge, à l’Unesco : « Que deviendrait la planète sans le travail des associations ? »
Motivés comme jamais
Il arrive ici ou là que les mobilisations portent leurs fruits et que des projets écocides finissent par être abandonnés, parfois en raison de la présence d’une espèce protégée, totalement zappée. Cependant, c’est loin d’être systématique, et il ne suffit pas qu’une organisation soit médiatisée pour que ça fonctionne. « Il y a du boulot », sourit Paul Watson. Lui n’entend pas abandonner la bataille, loin de là. Il est même « encore plus motivé » que jamais à défendre l’océan depuis sa libération, glisse-t-il.
« Quand on décide d’agir contre ou pour quelque chose, on ne sait pas si on va pouvoir gagner, néanmoins on y va quand même, témoigne Wolfgang Cramer. Quand j’ai vu que rien n’avançait dans la bonne direction sur la question de la crise climatique, je ne pouvais pas rester sur un canapé sans bouger. Alors je me suis engagé. » Pas possible de rester les bras croisés. Des citoyens sautent le pas, en espérant que d’autres suivent, bien sûr… « On a à créer une puissance collective, indique Léna Lazare. Souvent, on voit que le public nous soutient dans nos combats. C’est bien, mais on a besoin que les gens nous rejoignent », sourit-elle. / Philippe Lesaffre